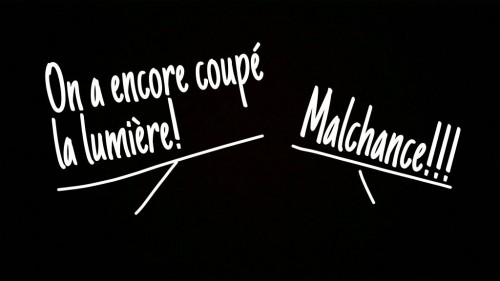Les amoureux sur le trottoir
Mon regard s’était posé sur eux. Deux jeunes. Une fille et un garçon. Ils devaient avoir quoi ? Dix-huit, vingt ans ? Je ne saurais le dire avec exactitude. Mais ce dont j’étais certain, c’est qu’ils étaient à la fin de l’adolescence, au seuil de l’âge adulte. J’étais déjà en train de regarder la rue quand ils sont entrés dans mon champ de vision. Ils riaient en chœur. Ils portaient tous les deux d’épaisses doudounes, un pantalon en jeans et des chaussures de sport. Ils avaient pénétré mon champ de vision, ils riaient de bon cœur et se sont arrêtés devant la porte de l’immeuble d’en face. Puis ils sont sortis de mon champ de vision. L’écran luminescent de l’ordinateur devant lequel je passais une grande partie de mon temps les avait remplacés. Il fallait que je me concentre à nouveau sur ce que j’avais à faire.
De l’endroit où je m’asseyais, il me suffisait de lever les yeux pour voir la rue. L’immense baie vitrée qui nous séparait du tumulte extérieur était comme un écran de cinéma qui me permettait d’observer la vie au dehors et parfois de laisser échapper mes pensées. A vrai dire, le tumulte, cette rue ne le connaissait pas vraiment. En dehors de quelques voitures qui passaient, sûrement à la recherche d’une place pour se garer, cette rue n’était pas très animée. Ah, oui ! Il y avait aussi des piétons qui passaient, notamment les étudiants de l’université toute proche, ainsi que les allées et venues dans l’immeuble d’en face.
La vaste salle qui nous servait de bureau était située de plain pied. Une immense baie vitrée sérigraphiée faisait rempart entre la chaleur douillette de l’intérieur et le froid extérieur. Cette baie vitrée avait une particularité qui nous offrait de bons moments de rires. Elle était presque opaque et, de l’extérieur, les passants avaient l’impression d’être face à un grand miroir. Les gens s’arrêtaient devant pour s’y mirer ; pour réajuster leur cravate, pour ébouriffer leur chevelure afin de la discipliner, certaines femmes en profitaient pour se remettre une couche de rouge à lèvres ou pour lisser leur jupe de leurs mains. Une fois même, une dame a profité de ce reflet pour scruter les interstices entre ses dents…
Il n’y avait pas que ceux qui auraient bien pu s’appeler Narcisse qui empruntaient le trottoir sur lequel donnait notre baie vitrée. Il y avait aussi des gens qui passaient là et qui ne remarquaient même pas sa présence. Comme ce groupe d’étudiants américains. J’avais décidé de les appeler ainsi, « le groupe d’étudiants américains ». Parce qu’ils parlaient cet anglais chantant si caractéristique des Yankees. Ils auraient tout aussi bien pu être des Canadiens ou encore des Australiens. Mais j’avais décidé que c’étaient des Américains. Parce-qu’il n’y a qu’eux pour se déplacer en meute bruyante, en braillant aussi fort. D’ailleurs, je me souviens qu’un jour j’avais déjeuné dans le même restaurant que cette bande. J’avais eu un petit sourire en observant la propriétaire du restaurant se démener comme un beau diable, dans un anglais un peu escamoté, saupoudré d’automatismes bien francophones, pour essayer de se faire comprendre d’eux. Beaux joueurs, ils ne s’étaient pas moqués d’elle, mais ils l’avaient corrigée gentiment.
Mis à part le groupe d’Américains, il y avait aussi ce vieux qui passait quelques fois. Il me fascinait. Sûrement nonagénaire, il était tout en rides et en petits pas rapides. Ce n’était même pas des pas. Il se contentait simplement de frotter ses souliers sur la dalle du trottoir et, dès que le talon du premier pied arrivait au niveau de la pointe du second, ce dernier prenait alors prestement le relais mais sans se décoller du sol. Et ainsi de suite… Une personne alerte pouvait traverser notre baie en six secondes. En revanche, il fallait à ce petit corps voûté, en appui sur sa canne, une bonne demi minute pour parcourir la largeur de notre écran de cinéma. Il repassait parfois, une ou deux heures après, avec le même rythme empressé. A chaque fois je me demandais où il allait et d’où il revenait. Où pouvait-il bien se rendre, plutôt que de rester chez lui ?
Mes yeux avaient encore quitté mon écran d’ordinateur, ils avaient atterri sur la rue. Ils étaient encore là. Cela devait faire une bonne dizaine de minutes qu’ils folâtraient devant la porte de l’immeuble. Les regards intenses échangés, les gloussements – je les imaginais plus que je ne les entendais -, leurs visages qui se rapprochaient et la main droite de la fille qui se frottait sur le manteau du garçon me fixèrent sur la nature de leur relation. Un échange de baiser, léger et aérien, me conforta dans le constat évident que je venais de dresser.
C’était à cette période de l’année où le climat est particulièrement rude. Cette semaine-là, on avait frôlé les dix degrés en dessous du zéro centigrade. C’était le genre de jours, où, avec le froid, on se met à courir dans la rue sans pouvoir se rappeler du moment où on a décidé de le faire. On trottine par réflexe, pour se réchauffer. Dans notre espace de travail, l’air conditionné affichait sur son écran la valeur maximale et, malgré cela, on se retrouvait parfois à frémir. Mais dans la rue ces deux-là faisaient fi de tout cela. Ce qu’ils ressentaient, de l’autre côté de la rue, à une vingtaine de mètres de moi, était plus fort que le froid. Peut-être pas totalement… j’avais remarqué qu’ils se dandinaient régulièrement sur place et qu’il se frottaient simultanément les mains, histoire de se réchauffer.
Le garçon se pencha et fit un autre baiser, cette fois-ci dans le cou de la demoiselle. Un monsieur, coiffé d’un béret et tenant un journal plié dans sa main, passa devant eux en les regardant à peine. Les amoureux étaient juste au niveau de la porte de l’immeuble, ils gloussaient toujours… quand une personne sortait de l’immeuble, elle trébuchait presque sur eux, systématiquement. Certains leur jetaient un regard contrarié, mais ils n’y prêtaient pas attention. Ils étaient sur ce trottoir. Mais ils étaient seuls. Plus rien autour d’eux ne comptait. J’étais admiratif. Je souriais. Cette scène me ramenait dans un passé bien lointain, un passé empli de regards brûlants, de cœurs battant follement, de chair de poule quand nous nous frôlions et de sourires complices. Nous nous souriions tout le temps…
Toutes les belles choses ont une fin. Tant mes souvenirs de regards brûlants et de sourires entendus que les dandinements des deux amoureux qui se bécotaient sur le trottoir d’en face. Mais cette fin-là fut particulièrement longue. Je les observais depuis une bonne quinzaine de minutes. Ils s’étaient pris dans les bras l’un de l’autre, ils se chuchotaient des choses à l’oreille, ils s’embrassaient passionnément, ils riaient à gorge déployée, puis ils s’embrassaient plus légèrement, ils avaient même ri timidement . Ils s’étaient à nouveau dévorés du regard dans de longs silences, avaient à nouveau pouffé de rire, s’étaient encore embrassé et s’étaient encore pris dans les bras. Toutes les bonnes choses ont une fin, mais cette fin-là semblait ne pas vouloir finir. Le garçon avait déjà tapé le code de la porte de l’immeuble deux fois, il était parvenu à pousser l’un des lourds battants une fois avant de le laisser se refermer pour mieux prendre sa douce dans les bras, avant de la couvrir de baisers.
Mais cette étreinte était bel et bien la dernière. Je le sentais. Je me rendais compte que j’avais tout abandonné pour fixer toute mon attention sur ce moment magnifique, ça ne pouvait pas finir ainsi. Pour la troisième fois, le jeune homme avait tapé le code de la porte, en avait poussé l’un des battants et le maintenait entrouvert. La demoiselle s’était éloignée de quelques pas. Il y avait désormais un immense mètre entre eux. J’étais seul dans la vaste pièce qui nous servait d’espace de travail. Et j’avais commencé à entonner pour moi-même : « un dernier, un dernier, un dernier ». Leurs au-revoir duraient encore. La fille s’éloignait peu à peu et la porte du garçon s’ouvrait de plus en plus. J’étais désespéré. Un dernier, s’il vous plaît ! Finissez d’embellir cette grise journée !
J’avais tout d’un coup bondi de mon siège, jubilant et applaudissant. J’exultais ! Je criais des « Yes ! Yes ! Yes !» en serrant le poing, tel un athlète qui avait remporté un trophée. J’étais hystérique ! La fille avait brusquement refait la distance qui les séparait, s’était hissée sur la pointe de ses pieds et avait déposé un baiser délicat sur les lèvres de son amoureux. Elle s’était ensuite retournée, était partie et le garçon avait refermé le lourd battant derrière lui.
Par René Jackson